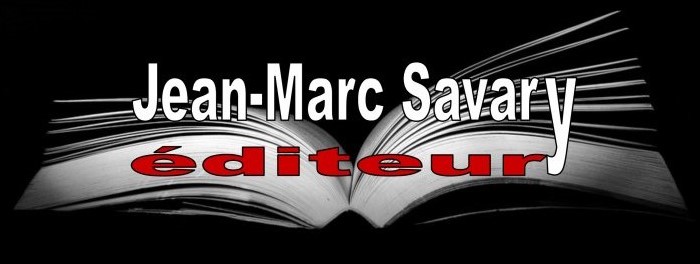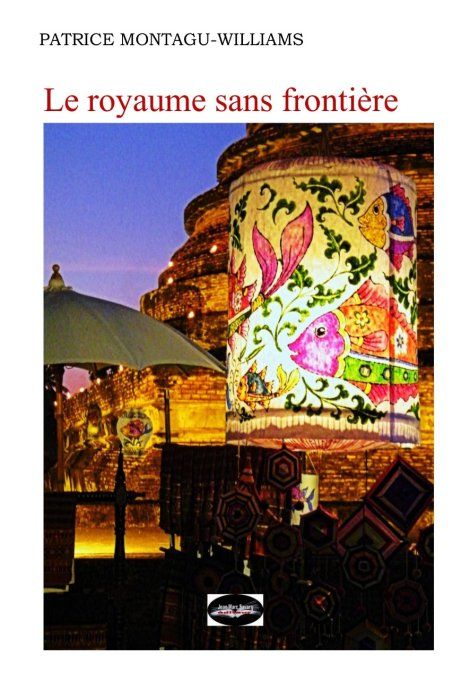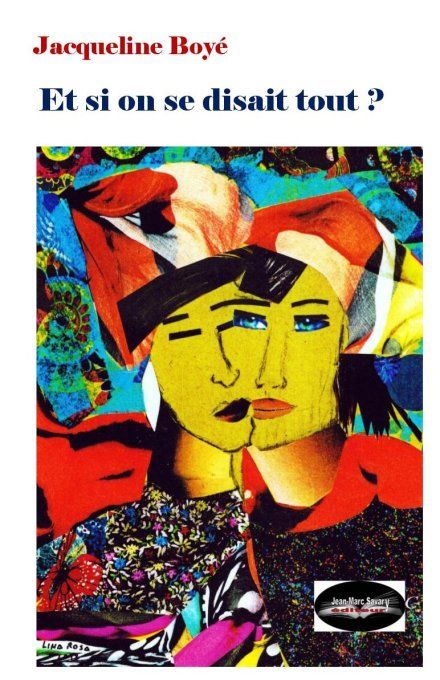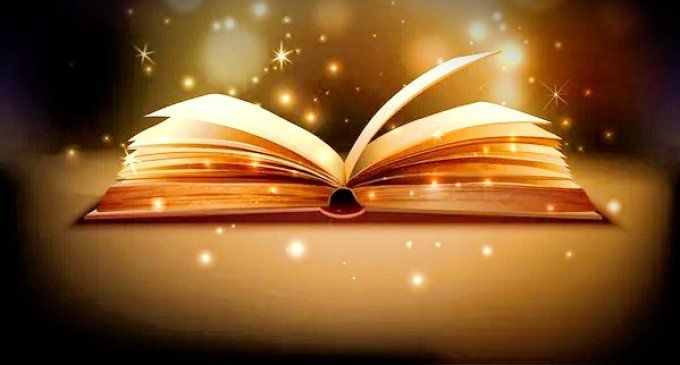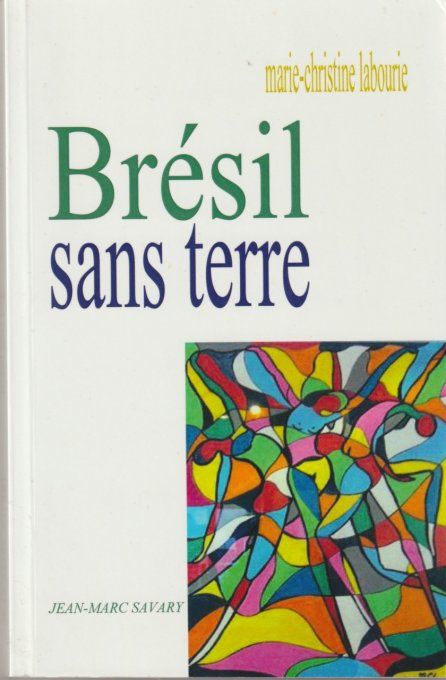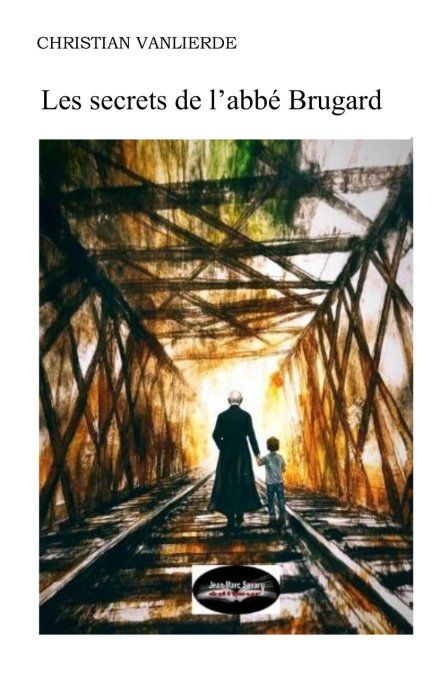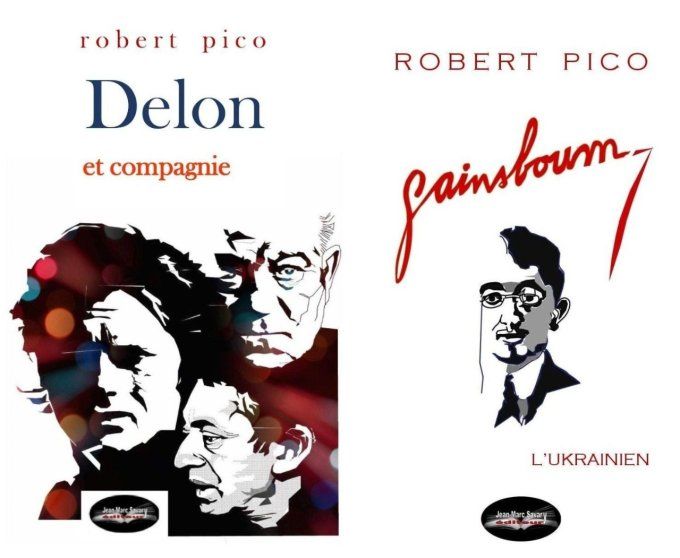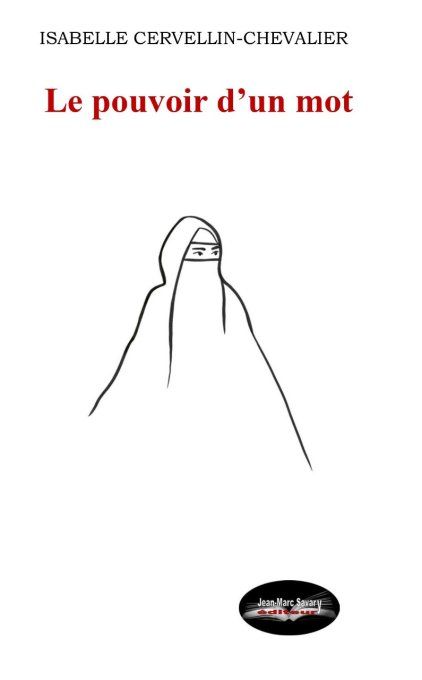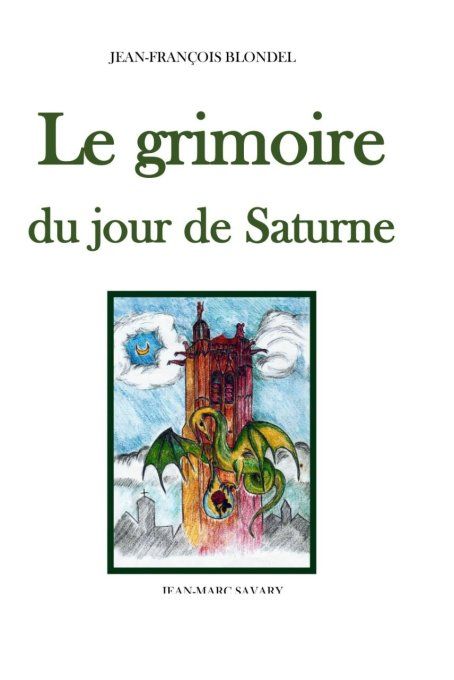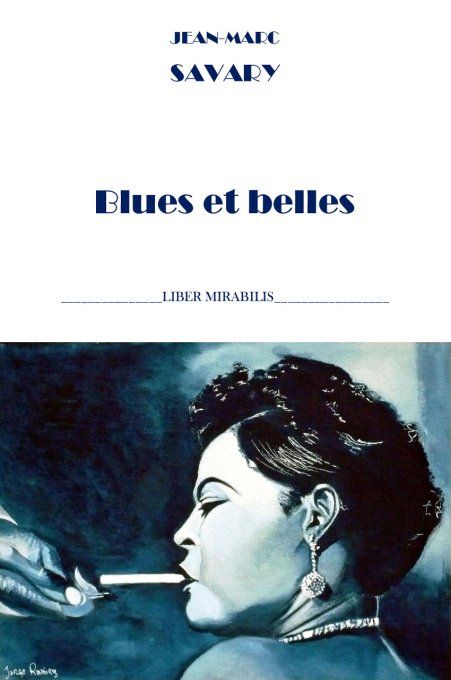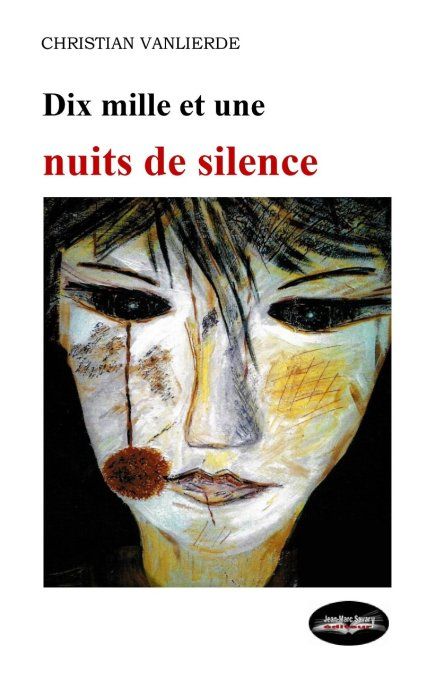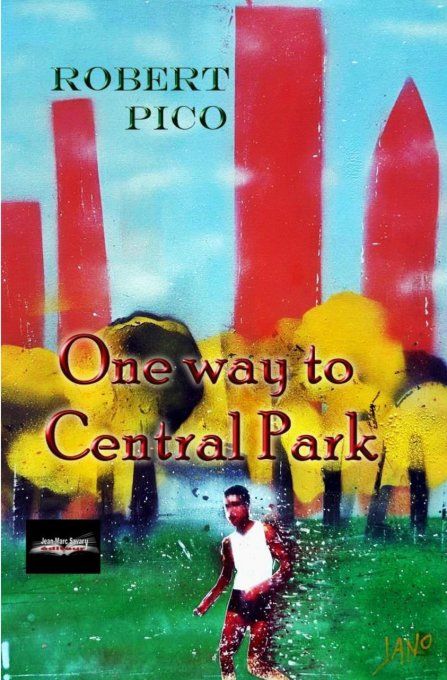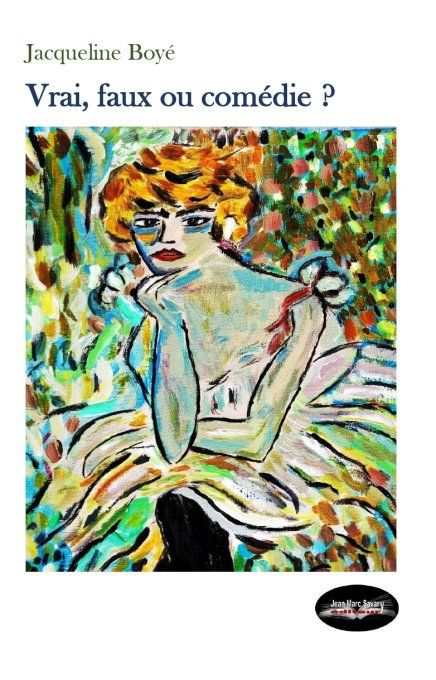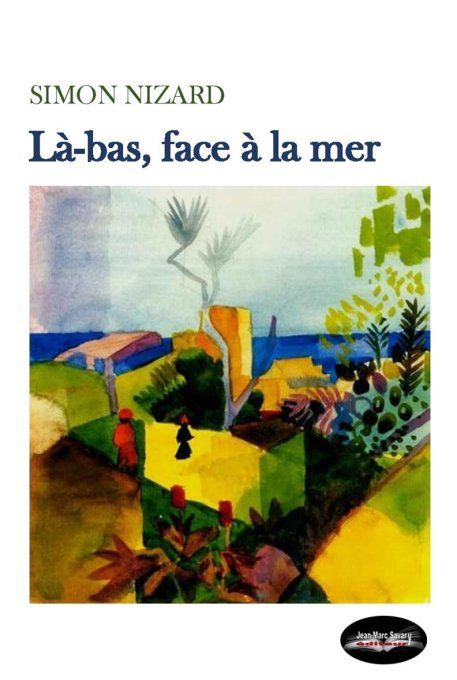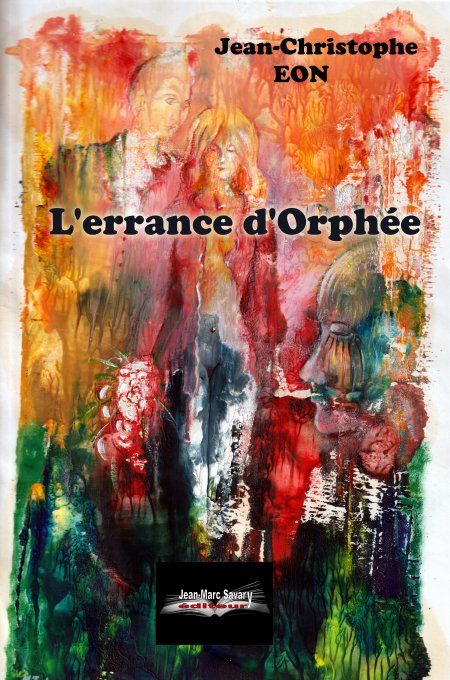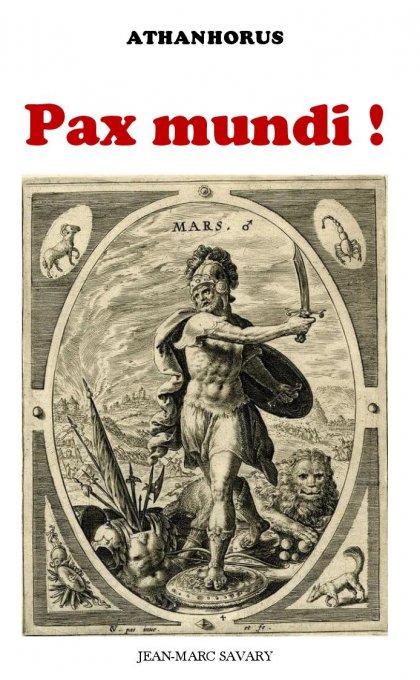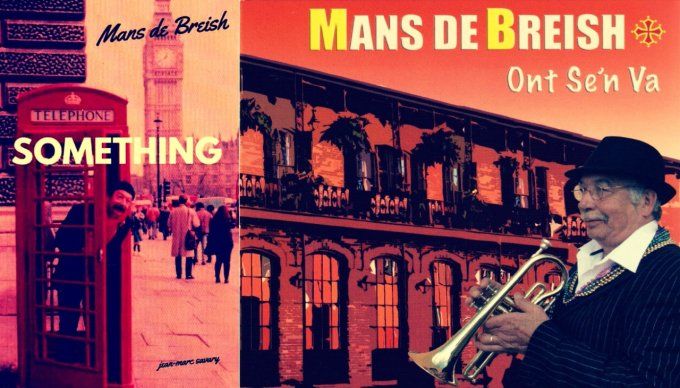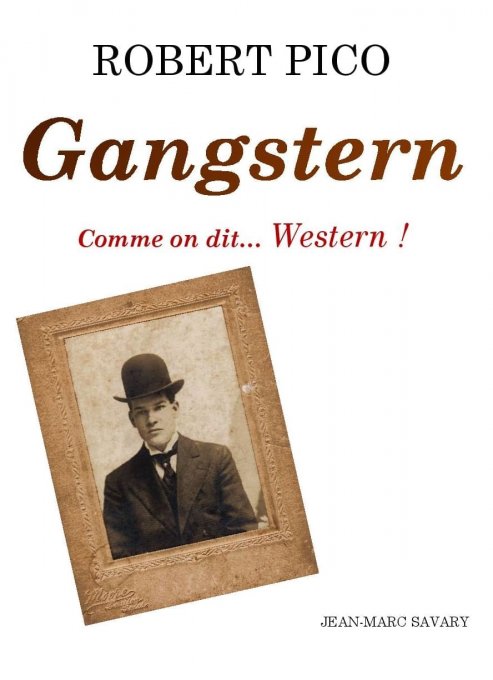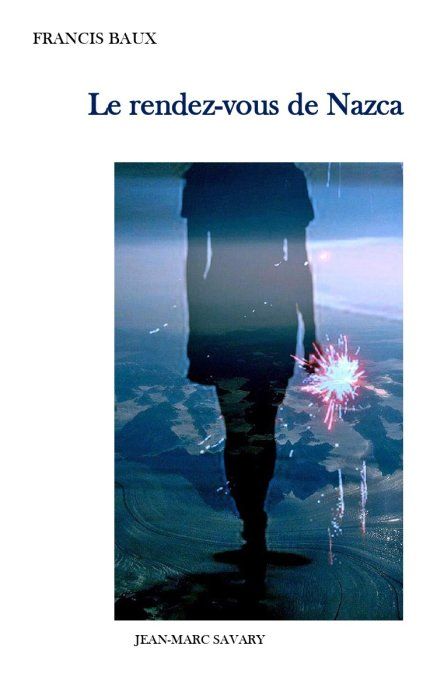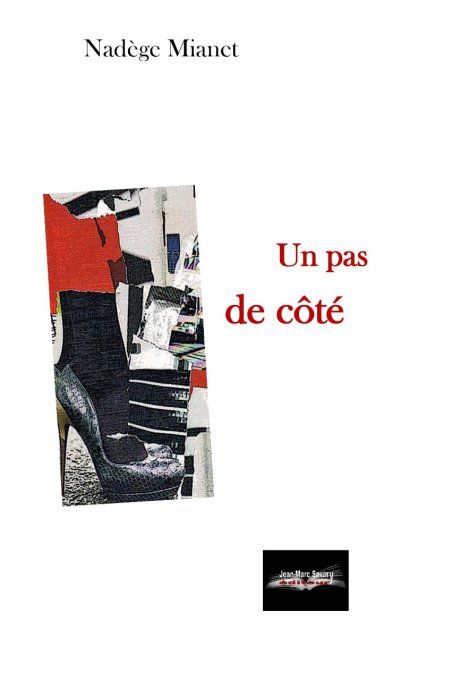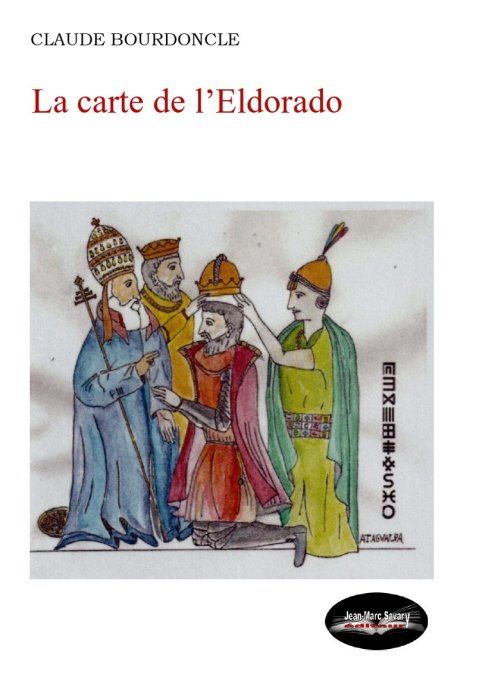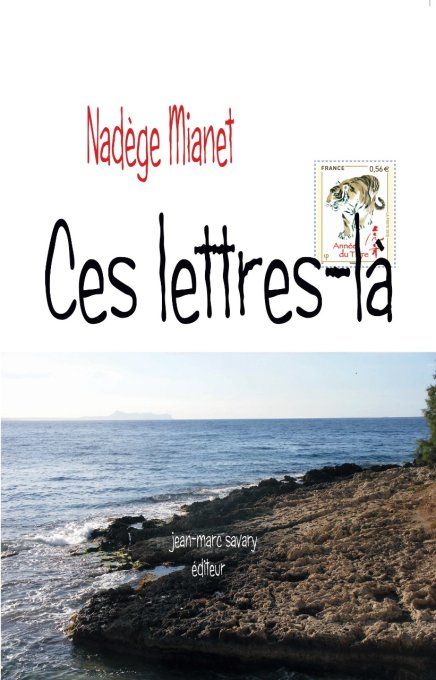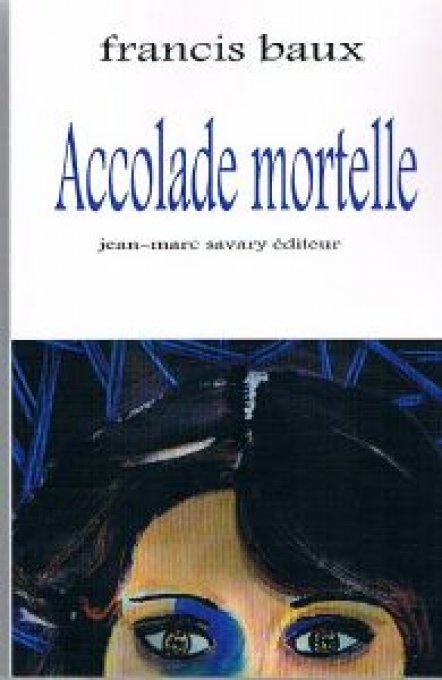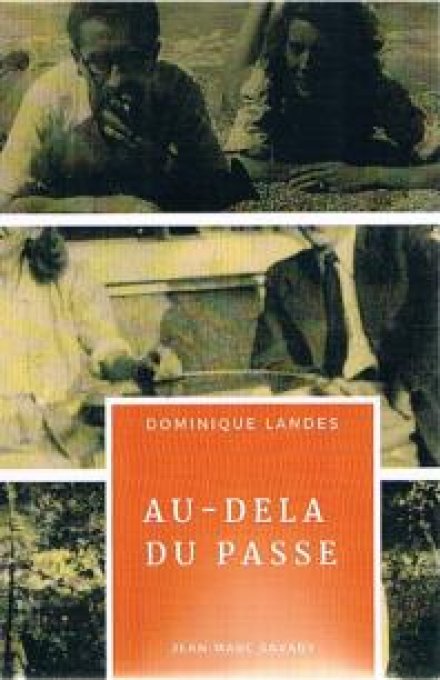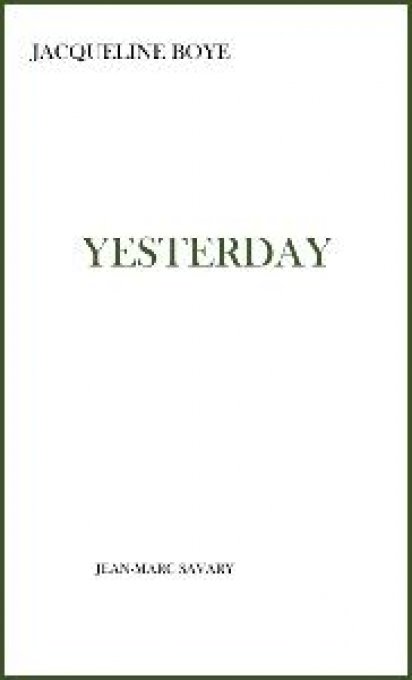ROMANS
SENS INIQUE, l'espion préfère les blonds
Ami d’Elizabeth Taylor et de Montgomery Clift, aventurier dans le monde et les mots, Michel Daviaud Beauchamp, alias Charles de Beauregard, entraîne son lecteur dans les coulisses du grand monde, de ses secrets...
20,00 €
Le royaume sans frontière
1996 : Agent de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, et spécialiste de l’Asie du Sud-Est, Martin Decoud est envoyé en mission à Bangkok.
20,00 €
Et si on se disait tout
Mêlant fantastique et quotidien, Jacqueline Boyé nous entraîne dans un roman d’une étonnante actualité tout en soulevant, par touches discrètes, de profondes interrogations philosophiques en laissant libre le lecteur dans son appréciation…
20,00 €
BRESIL SANS TERRE
Brésil sans terre est un roman de Marie-Christine LABOURIE qui a obtenu le : PRIX DU PUBLIC, PLUMES DE FEBUS Festival du livre d'Orthez.
20,00 €
Les secrets de l'abbé Brugard
Une vie. Une famille encombrée de non-dits. Encombrée de mensonges et de crimes. Une petite ville du Nord sur la Lys, à cheval sur la frontière belge. Période difficile, ravagée par la guerre. « Henriette » raconte l’histoire douloureuse de cette famille
20,00 €
Delon et compagnie
Robert Pico ne raconte pas la vie d’Alain Delon, mais ses huit ans passés dans le showbizz (années 60) et ses exceptionnelles rencontres.
20,00 €
Delon et compagnie et Gainsboum
Les deux livres "Delon et compagnie' et "Gainsboum" à un prix promotionnel.
30,00 €
LE POUVOIR D'UN MOT
Isabelle Cervellin-Chevalier a partagé le quotidien d’étudiantes saoudiennes de 2008 à 2016, de l’université jusque dans leur intimité familiale. De la confrontation de ces cultures et du questionnement profond sur la notion de liberté est né ce roman.
19,00 €
LE GRIMOIRE DU JOUR DE SATURNE
Selon la Tradition, les étapes du Grand Œuvre d'alchimie se trouveraient gravées sur les murs de certaines cathédrales, en des fresques discrètes accessibles à tous, mais ayant un sens caché, compréhensible aux seuls initiés, et aux "quêteurs d'absolu".
15,00 €
Blues et belles
Dans ce recueil réunissant trois novellas, Jean-Marc Savary swingue avec les mots entre femmes et univers.
15,00 €
Dix mille et une nuits de silence
"Dix mille et une nuits de silence", roman de Christian Vanlierde, préface par Franck PAVLOFF.
18,00 €
One way to Central Park
Frank Rockaway court le marathon de New York. Dès le départ, sur Staten Island, c’est pour lui “comme s’il venait de naître” et, au fil des miles, il a l’impression de “vieillir”.
17,80 €
Pardon de ne pas t'avoir désirée
La découverte d’une histoire pleine d’humanité à laquelle nous convie Jacqueline Boyé dans son nouveau roman.
21,00 €
Vrai, faux ou comédie ?
Ce roman de Jacqueline Boyé est la suite de "Pardon de ne pas t’avoir désirée."
21,50 €
La saga en 2 volumes : Pardon de ne pas t'avoir désirée
Les deux volumes de la Saga : "Pardon de ne pas t'avoir désirée' de Jacqueline Boyé
38,00 € 42,50 €
La légende du Guerrier
Jean-Marc Savary nous offre ici un nouveau conte initiatique, parchemin d’une époque inconnue. La lecture nous restitue le souffle d’une saga norroise et l’imprévu d’une épopée irlandaise.
15,00 €
GAINSBOUM
GAINSBOUM : Ami de Serge GAINSBOURG, Robert Pico dresse le portrait de son père, Joseph Ginsburg, et révèle l’initiation aux arts du futur chanteur.
15,00 €
SPIRITUS MUNDI
Dans cette suite du roman Pax mundi !, la dimension symbolique, philosophique, voire philosophale, transforme l’aventure en authentique Initiation.
23,00 €
La saga en deux volumes : Pax mundi !
La saga en deux volumes : Pax mundi ! d'Athanhorus
39,00 € 46,00 €
LE GIGOT A LA FICELLE
LE GIGOT A LA FICELLE est un roman de Jean-Marc SAVARY " Un ouvrage qui vous donnera faim, autant par ses «odeurs» culinaires que par sa délicatesse d'écriture." BSC NEWS
15,00 €
Harcelée !
Inspirée par une histoire vraie, Jacqueline Boyé évoque le grave phénomène du harcèlement qui frappe Agathe, femme vraie au caractère trempé et au cœur d’or.
21,00 €
SOMETHING
Something est un roman autobiographique de Mans de Breish. Une chanson, pas plus. Qui n’a jamais associé un souvenir à une quelconque chanson ?
12,00 €
Something et le CD Ont Se'n Va proposés ensemble !
Le roman de Mans de Breisj "Something" et son CD "Ont se'n Va proposés ensemble !
22,00 €
Something et le CD La guerra bartassiera
Le roman "Something" et le CD "La guerra bartassiera" proposés ensemble !
22,00 €
GANGSTERN, comme on dit... Western !
"Gangstern, comme on dit... Western", roman d'aventures de Robert PICO
23,00 €
LA TENTATION DU MENSONGE
La tentation du mensonge est un roman de Charles FERRIOL salué par "Télé-loisirs" qui lui a attribué 4 étoiles !
20,00 €
LES TEMPLIERS DE VALCROSE
LES TEMPLIERS DE VALCROSE est un roman qui dépeint le Massif des Maures à l'époque des Templiers et qui nous initie à un secret puissamment gardé.
23,00 €
L'HOMME AUX YEUX DOUX
Se déroulant dans le Sud de la France, de Montauban à la Provence, en passant par Carcassonne ou Béziers, cette histoire nous entraîne aussi dans les coulisses de l’Art…
19,00 €
LE RENDEZ-VOUS DE NAZCA
Le rendez-vous de Nazca est un roman de passion de Francis Baux et qui interroge sur les "hasards" d'une vie...
15,00 €
UN PAS DE COTE
Un pas de côté est un roman de Nadège MIANET. ce « pas de côté », est le tango qui murmure l’espoir des peuples.
20,00 €
LA CARTE DE L'ELDORADO
La carte de l'eldorado est un roman de Claude Bourdoncle. Au lecteur de découvrir tous les indices laissés sur la carte par le frère Dominique qui le mènera à une cité d’Or.
25,00 €
8 SECONDES A MANHATTAN
8 SECONDES A MANHATTAN, roman de Robert PICO. "Un grand livre : visuel, métaphorique, cinglant. Complètement dingue !" Woody McPherson « New York Morning News »
12,00 €
CES LETTRES-LA
CES LETTRES-LA est un roman de Nadège MIANET. « Ces lettres là » sont une ode à l’enfance.
16,00 €
ACCOLADE MORTELLE
ACCOLADE MORTELLE est un polar de Francis BAUX. "Un auteur, donc, à découvrir à sa juste valeur !" Marie Barillon Blastingnews
13,00 €
AU-DELA DU PASSE
Au-delà du passé est un roman de Dominiques LANDES. Dans ce roman flamboyant, Dominique Landes nous entraîne dans une belle fresque située dans la période troublée de 1936 à 1945.
25,00 €
YESTERDAY
YESTERDAY est un roman de Jacqueline Boyé. "Chacun se reconnaîtra dans Yesterday !" La dépêche du midi
15,00 €
Bouleversantes rencontres
Jacqueline Boyé, fascinée par les belles histoires humaines, signe un roman d’une actualité brûlante et rappelle que la plus grande des aventures est la rencontre de l’autre.
21,00 €