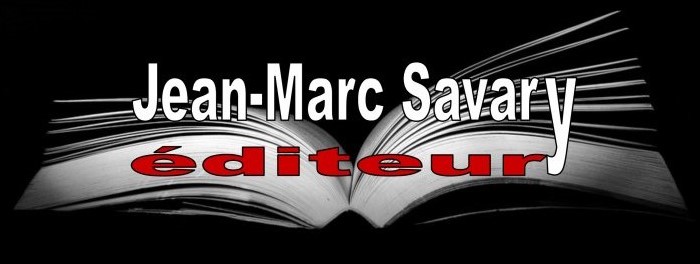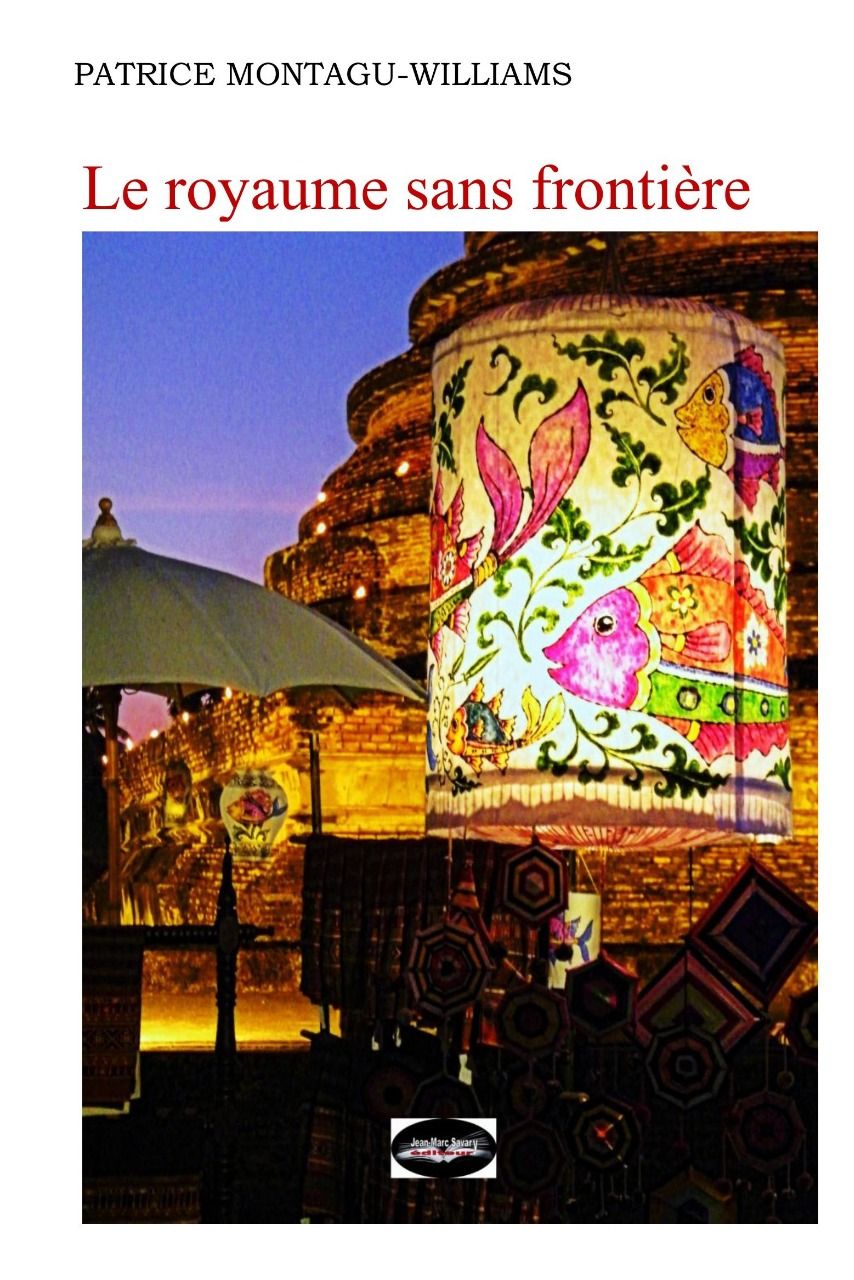Le royaume sans frontière
1996 : Agent de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, et spécialiste de l’Asie du Sud-Est, Martin Decoud est envoyé en mission à Bangkok.
" La lecture se fait simple, exempte de trop de descriptions, et allant droit au but. Ici, aucun faux-semblants. Les personnages ne sont jamais parfaits mais terriblement humains. Espionnage, rencontres d'une nuit, prostitution, meurtre, vengeance, mais aussi amour et amitié, l'auteur nous peint des êtres profondément réels. Ce roman est aussi une belle ode à la nature, "
Chronique littéraire de Marie-Anne Chiaverini - bookstagram
️ "Aventure, Amour, amitié, vengeance et nature. Un beau cocktail pour ce roman."
Blog "Ma Mots et images"...
"De l'exotisme, de l'aventure, de l'action, de l'amour. "
Blog "Argoul"
LE ROMAN
1996 : Agent de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, et spécialiste de l’Asie du Sud-Est, Martin Decoud est envoyé en mission à Bangkok. Il adoptera à cette occasion une petite réfugiée qu’il ramènera avec lui à Paris. Cet enfant bouleversera sa vie. Persuadé que, comme le dit Ernest Hemingway, « Un homme, ça peut être détruit, mais pas vaincu », le farang, l’étranger, retournera en Thaïlande un quart de siècle plus tard pour une dernière mission qui lui permettra de reconstruire une existence brisée.
Embarquez pour un voyage sans retour au pays des mythes et des légendes…
PATRICE MONTAGU-WILLIAMS
Petit-fils de deux agents des services secrets britanniques (MI6), mis à la porte du Collège Stanislas de Cannes, comme Guillaume Apollinaire et pour les mêmes raisons (lecture de livres interdits), diplômé de l’ESCP Business School, Patrice Montagu-Williams a exercé ses talents dans le commerce international, ce qui lui a permis de découvrir le monde. II a vécu à Paris puis à Rio de Janeiro (il est marié à une Brésilienne) avant de s'installer à Athènes où il a pu enfin assouvir pleinement sa passion pour l'écriture. Son premier manuscrit, un roman policier intitulé La Porte de Jade, premier opus d'une série consacrée aux enquêtes du commissaire Samarcande, est publié pour la première fois, en 2012, aux éditions BALLAND.
LES PREMIERES PAGES
I Très cher passé
1
Enfant de la Butte
L’homme est grand, brun et bien bâti. Deux yeux bleus bridés se détachent sur une peau au teint mat. C’est ce contraste entre une carrure athlétique et un visage quasiment imberbe et presque féminin aux traits fins qui plaît aux femmes. Martin Decoud est cependant toujours célibataire à un peu plus de trente ans. Ce n’est pas un choix : c’est l’une des contraintes de son job. Bien sûr, il ne peut pas avouer à ses nombreuses conquêtes quel est son métier. Il est vrai que les objets qui décorent son appartement pourraient le trahir : pas seulement l’immense reproduction de Garuda, l’homme-oiseau, la monture du dieu Vishnou dans la mythologie hindouiste, qui est aussi l’emblème national de la Thaïlande et trône au-dessus du lit où il entraîne ses victimes consentantes, mais aussi les six bonzes sculptés dans du bois de manguier peints puis vernis, le plus grand étant le plus sage et le plus accompli, qui sont alignés sur le buffet du salon. Et ceci sans parler des nombreux vases en benjarong, la céramique royale, une porcelaine peinte dont le nom signifie « cinq couleurs », mais qui peut en comporter de trois à huit et dont le processus de fabrication est long et délicat, car la pièce doit être passée au four entre chaque application. Alors, il prétend qu’il est dans l’import-export et qu’il a rapporté tous ces souvenirs de ses nombreux voyages en Asie.
Avec celles, plus malines que les autres, qui ont deviné qu’il ne s’agissait que d’une couverture, il préfère rompre. D’ailleurs, pour des raisons de sécurité, il fait en sorte que ses liaisons ne dépassent jamais plus de trois mois.
C’est qu’il ne veut pas s’attacher, comme il l’avait fait avec Jane, cette Américaine avec laquelle il parcourait Paris sur les traces de Fitzgerald, Hemingway, Miller, Dos Passos ou Anaïs Nin, passant et repassant rue Jacob, là où Nathalie Barney tenait salon, traînant au Select, à La Rotonde, au Dôme, à la Closerie des Lilas ou chez Shakespeare & Company. C’est elle qui lui expliqua que la mort d’Isadora Duncan, étranglée par son long foulard de soie qui s’était pris dans la roue du roadster Amilcar qu’elle conduisait sur la Promenade ses Anglais, à Nice, fut le signal de la fin de cette époque où le Tout-New-York vivait à Paris et sur la Côte d’Azur.
Et puis Martin découvrit un jour que Jane disposait d’un second téléphone, apparemment crypté, dont elle lui avait soigneusement caché l’existence. Il mit alors un point final à leur histoire.
Avec les copains, ceux qu’il retrouve chaque samedi à La Mascotte, rue des Abbesses, c’est un peu différent. Il leur a avoué pour qui il travaillait, mais en prétendant qu’il était rattaché à la direction de l’administration. Ils ont fait semblant de le croire et n’en ont plus jamais parlé. C’est ça les amis, s’était-il dit…
Martin les aimait tous, ces « Mercenaires du Gosier en Pente Raide », comme il les appelait. C’était un peu des naufragés, des gars qui naviguaient, inconscients, à la surface de la vie, le souffle puissant de leurs rêves gonflant les voiles de leur imagination quand, un beau jour, patatras : le monde réel s’était rappelé à eux sous la forme d’un iceberg que leur radar n’avait pas vu venir. La coque s’était déchirée et l’eau avait envahi la cale. Impossible de colmater les brèches. Tout le monde à la flotte !
Dégoulinants, hagards, ils s’étaient alors hissés à bord d’un radeau de fortune sur lequel ils avaient posé leur sac qui contenait tout ce qu’ils avaient pu emporter avec eux, des choses qui, souvent, ne valaient rien, mais qui pesaient très lourd, comme des souvenirs, par exemple.
Ce radeau, c’était La Mascotte. À sa création, en 1889, le café occupait tout le rez-de-chaussée d’un hôtel de deux étages. C’était alors plus ou moins un bordel, qui s’appelait Le Pompéia, où Édith Piaf et son pianiste vécurent dans les années trente. Depuis, la brasserie était devenue un peu la mémoire du quartier, mémoire qui résistait encore au piétinement quotidien des centaines de milliers de touristes qui venaient paître à longueur d’année dans le coin, l’œil glauque et la lippe pendante, façon vache laitière.