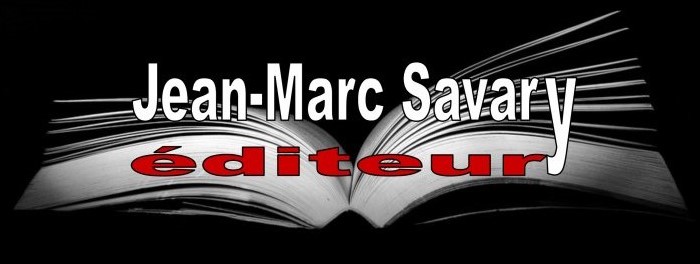SOMETHING
Something est un roman autobiographique de Mans de Breish. Une chanson, pas plus. Qui n’a jamais associé un souvenir à une quelconque chanson ?
Une chanson, pas plus. Qui n’a jamais associé un souvenir à une quelconque chanson ? Il s’allume soudain comme une vieille chandelle, tout doucement puis éclaire tout l’espace de la pensée. Une danse sur cet air, dans une chambre d’adolescent, au son d’un vieil électrophone. On la serre de près, du plus près que la décence ne le permet, et on sent, pour la première fois, le parfum troublant de la femme en devenir et de l’amour y afférant.
LES PREMIERES PAGES DE SOMETHING :
Les avions, flèches neigeuses tirées par un archer céleste, traversaient le ciel de mon enfance. J’imaginais à leur bord des personnes de la plus haute importance : stars de cinéma, hommes d’affaires, dirigeants de pays qui traversaient les continents pour leur business. Ils ne voyaient sûrement pas ce ver microscopique qui levait la tête vers eux, mesurant les kilomètres de vide qui séparaient l’enfant de paysan de ces grands personnages. Comment prévoir, dans ces temps déjà lointains et avec un cerveau d’enfant, que plus tard on prendrait l’avion comme on prend l’autobus ? Le temps de l’enfance enfui avec ses rêves, ses illusions et, surtout, cet avenir que l’on imaginait tellement autre que ce qu’il a finalement été. Cette enfance qui modèle définitivement la glaise du futur homme, vite suivie de l’adolescence et des premiers essais du statut d’adulte. Le savoir, les expériences, les échecs, les découvertes, tout ce qui devient vite souvenirs remonte à la surface lorsque l’âge vient troubler l’eau calme de l’habitude.
Je somnole, pris dans ce rêve infantile, la tempe sur la fraicheur du hublot. Qu’il fait chaud dans les avions ! Le ronron des réacteurs m’a gentiment bercé. Il faut dire que, la nuit dernière, j’ai mal dormi ; maintes fois réveillé avec, en tête la même question : partir ou pas ? Puis replongeant dans un sommeil agité jusqu’au prochain réveil où la même question revenait me tarauder. Bref, je tente vainement de récupérer en quelques minutes le manque de sommeil de la veille.
Les avions ont cette odeur particulière, mélange de kérosène et de lingettes rafraîchissantes au parfum entêtant. Tout y est : les passagers, tous inconnus, les hôtesses hautes sur talons, tailleurs stricts, foulards aux couleurs de la compagnie, maquillages discrets et sourires règlementaires. Elles nous traitent, nous les passagers classe touriste, comme si nos noms étaient inscrits dans le bottin mondain.
—Thé ou café monsieur ?
—Thé s’il vous plait.
Puisque j’y suis, mieux vaut m’acclimater tout de suite.
Je lui ferais bien un brin de cour à l’hôtesse qui me tend de sa main gantée un gobelet où pendouille une étiquette Ceylan. Mais je pense qu’être draguée par un passager est, pour les hôtesses d’un ordinaire navrant ; surtout de la part des costard-cravate qui plongent en ce moment leur nez dans des dossiers ultra importants mais qui seront obsolètes avant que leur encre ne palisse. Vains décideurs d’un avenir qui, quoiqu’ils fassent, leur échappera.
Derrière moi, de jeunes touristes de retour d’Espagne se remémorent leur séjour en poussant des cris de souris apeurées. Elles se montrent, l’une à l’autre les souvenirs incontournables de l’Espagne de pacotille : des toros noirs, des castagnettes et autres babioles typiquement ibériques fabriquées en Asie du Sud-est. Leur peau, rougie par le sel et le soleil fera pâlir d’envie leurs copines restées chez elles, faute de vacances. Le soleil roi, devenu indispensable à la détente, à l’oubli du quotidien comme un culte et ses rituels conduisant à la transe libératrice.
D’autres passagers, sans caractère ou ne désirant pas en afficher un, ne font que voyager pour la seule raison qui est la leur, n’en font pas une affaire et restent silencieux.
L’hôtesse me débarrasse de mon gobelet vide. Le voyant des ceintures s’allume dans un tintement de porte d’épicerie rurale. La voix règlementairement suave annonce notre descente. Ça cliquette ; les ceintures que l’on boucle, les cartables que l’on ferme, les tablettes que l’on relève. On se détend dans la quiétude des réacteurs qui ralentissent ; surtout ceux qui ont peur de l’avion et qui voient la fin de leur calvaire enfin se profiler. On pense à ce qui nous attend au bout du voyage, à ce que l’on va faire après être arrivé à destination, à ceux que l’on va rencontrer ; collègues, amis, connaissances, inconnus que l’on va apprendre à connaitre. On se prépare à revenir sur terre, vers ce pourquoi on est là.
Mais moi, qu’est-ce que je fous dans cet avion ?
Le cartable que j’ai jeté sur mon bureau va rester là, flasque et poussiéreux, pendant deux mois. Les vacances, les vraies. Deux mois sans ces têtes endormies qui vous regardent, n’écoutent pas et pensent à autre chose. Des têtes qui n’attendent que la fin du cours pour aller fumer et flirter. Des têtes que vous tentez en vain de remplir de quelques bases d’anglais, de vocabulaire, de grammaire. Des têtes qui ne les retiendront jamais mais qui mettent de l’anglais mal à propos à chacune de leurs phrases. Deux mois sans cours, sans corrections, sans discipline à faire respecter, sans les collègues, le collège, les collégiens. Prof d’anglais en vacances, quoi.
J’ai bien droit à un apéritif. Fi des boissons industrielles que la publicité nous impose. J’ai le goût de ce qui est issu du travail conjoint de l’homme et de la nature. Alors mon apéritif préféré : du vin doux naturel à base de muscat dans un verre préalablement glacé au frigo. Mon fauteuil préféré au beau milieu de mon « ile », mon appartement, deux pièces et cuisine dans un quartier calme avec vue sur l’immeuble d’en face, acquis grâce à l’héritage parental. Voila qui me suffit. Vivant seul, j’ai de quoi m’isoler d’un monde qui me dépasse, que je ne fréquente guère et dont je m’évade parfois pour aller pêcher en Ardèche ou ailleurs. Un monde qui se dégrade à mesure qu’il évolue techniquement, un monde qui isole les individus à mesure qu’il offre des moyens de communication, un monde où Droite et Gauche ne signifient plus rien, un monde qui a enterré ses utopies pour mieux s’enterrer lui-même. Bref un monde auquel je cesse de penser pour allumer la radio.
Une radio qui va bouleverser tout ce qui était prévu, tout ce qui devait arriver sans surprise dans ma vie de petit fonctionnaire de l’Education nationale. Un zèbre ordinaire me vante un quelconque produit dont je n’ai nul besoin mais qui, pourtant est indispensable dans tous les ménages modernes, puis la musique. Harrison chante :
Something in the way she moves…