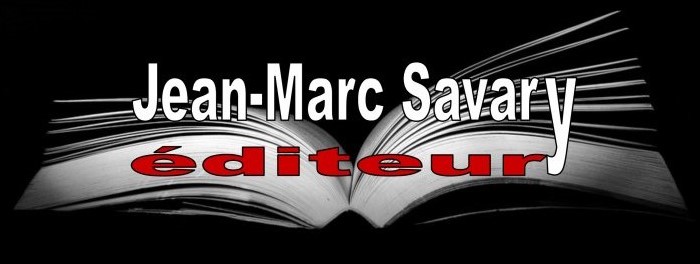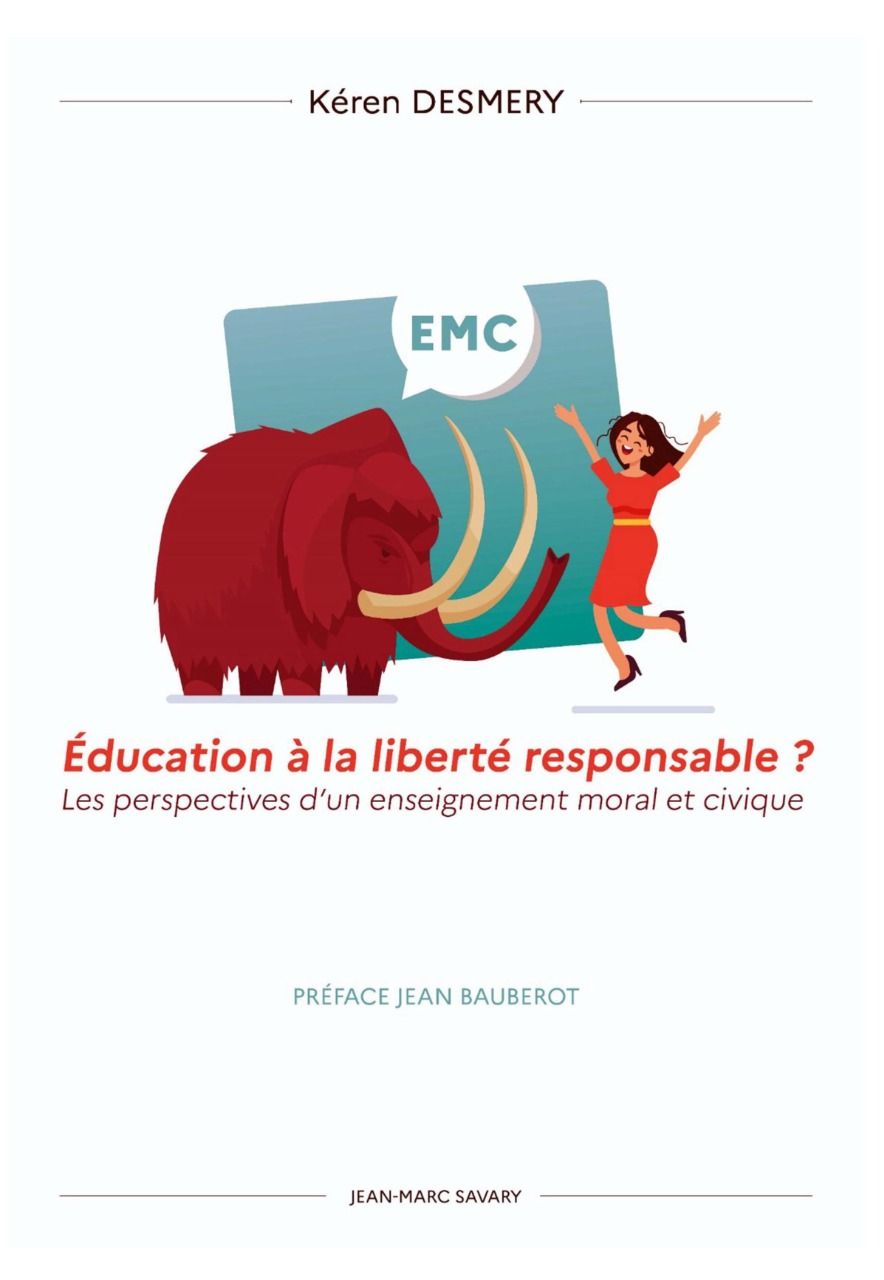EDUCATION A LA LIBERTE RESPONSABLE ?
Éducation à la liberté responsable, les perspectives d'un enseignements moral et civique de Kéren DESMERY.
« Cette spécialiste a calculé que le mot « respect » était employé 59 fois dans les programmes de 2018, pour 14 occurrences en 2015."
LE MONDE

Préface de Jean BAUBEROT
Ce livre s’adresse à toute personne un tant soit peu soucieuse des interrogations liées à un « mieux vivre ensemble » tant dans l’enceinte scolaire qu’au sein de notre société.
Ce livre constitue le premier Opus de notre étude liée à la naissance de cet Enseignement Moral et Civique et les obstacles que ce dernier a dû affronter pour -théoriquement-entrer en vigueur dans toutes les écoles publiques de France, de la primaire au Lycée, toutes filières confondues entre 2015 et 2017.
Ce livre s'appuie sur un travail de terrain effectué auprès des membres du Système Éducatif, de la base au Sommet,mais aussi d’entretiens avec des Politiciens, des Juristes, des Chercheurs et des Citoyens « lambda » !
EMC : Trois lettres pour désigner un seul et unique enseignement moral et civique, spécifique à toutes les filières, afin d’assurer dès lors « une meilleure visibilité », mais aussi une certaine « continuité » (Vincent Peillon) entre les cycles. Dans cette optique, il aurait pu ainsi permettre, à son échelle, d’éduquer à une liberté responsable.
C’était du moins l’une de nos hypothèses de départ...
LES PREMIERES PAGES DE EDUCATION A LA LIBERTE RESPONSABLE ?
Les perspectives d’un enseignement moral et civique
La laïcisation de l’école publique, opérée par la loi du 28 mars 1882, a induit un changement fondamental concernant l’enseignement de la morale. Jusqu’alors un cours de « morale religieuse » figurait au cœur des programmes ; désormais instituteurs et institutrices donnèrent un cours d’instruction morale et civique, bientôt qualifié d’enseignement de la « morale laïque », morale qui d’ailleurs informait l’ensemble des matières enseignées aux élèves. Cette formule de « morale laïque » est devenue l’expression historique des objectifs éducatifs de l’école publique à la fin du XIXe siècle et durant la première moitié du XXe siècle.
S’agit-il maintenant d’une vieille histoire, depuis longtemps dépassée avec « l’évolution des mentalités », la « libéralisation » des mœurs », la « pluralisation de la société » etc., mais cela est moins avouable, avec l’injonction sociale incessante, à privilégier le « faire » sur « l’être, à marginaliser les interrogations sur le « sens de la vie » ? Beaucoup l’ont cru, certains le croient toujours, et un des nombreux mérites de l’ouvrage que j’ai le plaisir de préfacer, consiste à montrer le malaise des promoteurs du cours actuel d’enseignement moral et civique (EMC) face à l’expression même de « morale laïque » : elle désignait initialement le projet et a été abandonnée en cours de route, indice d’une attitude ambivalente. Et pourtant, j’y reviendrai à la fin de ma préface, l’enjeu de l’EMC est bien une actualisation de la morale laïque, dans le contexte du XXIe siècle.
D’ailleurs, même les personnes qui ont des réserves, des interrogations légitimes, ne peuvent ignorer que, périodiquement, surtout depuis la fin du XXe siècle, la question du rôle de l’école en matière de « morale » -terme pris dans un sens extensif- se repose, à nouveaux frais. Que la « gauche » ou « la droite » soient au pouvoir, personne n’a pu esquiver le problème, faute de le résoudre de façon stable. Diverses tentatives ont été faites, dont en 1997-1998, les « Initiatives Citoyennes » de la ministre Ségolène Royal, sans forcément s’avérer durables. C’est la preuve de la nécessité de l’entreprise, mais aussi de ses difficultés. Souvent, ce qu’un ministre élaborait, son successeur se dépêchait de s’en désintéresser, voire de promouvoir un autre projet, également mis en question par le ministre suivant. Sans compter les craintes de nombreux enseignants, qui redoutent un enseignement « passéiste » ou qui favorise un « ordre moral », et auxquelles l’institution scolaire n’a peut-être été totalement capable, en son temps, de fournir des réponses claires.
Il n’en reste pas moins que la demande sociale d’un « enseignement de la morale à l’école » s’avère récurrente. Elle peut être sociologiquement expliquée par trois raisons principales :
La première raison est l’histoire récente de la France et l’épaisseur historique présente dans toute société. Depuis un peu plus d’un demi-siècle, les repères moraux sont devenus « flottants ». L’individu contemporain est socialement incité à être un « aventurier » qui doit se montrer capable d’inventer lui-même l’itinéraire matériel et moral de sa propre vie. Il est de bon ton de magnifier ou de dénoncer « l’individualisme » contemporain. Mais, en amont, il s’agit de comprendre sa construction sociale. Elle comporte des aspects politiques : dans l’idéal démocratique, les normes ne doivent plus être imposées et le citoyen est considéré comme libre et responsable. Elle comporte également des aspects socio-économiques : ce n’est pas un hasard si l’ancien cours de morale laïque a été supprimé au cours de la période qualifiée, a postériori, des « Trente Glorieuses » (1945-1975).
Celles-ci ont plutôt duré quinze ans, avec « Mai 68 » en leur centre car, dans l’après-guerre, de durs efforts ont été demandés pour reconstruire le pays ; d’autre part les guerres coloniales, ainsi que l’instabilité politique pesaient lourd : les gens se seraient montrés très surpris si, venant du futur, un spécialiste leur avait annoncé qu’ils vivaient des années « glorieuses » ! En revanche, à partir des années 1960, les efforts fournis, la fin des conflits liés à la décolonisation, la stabilisation de la République, la croissance ont permis aux échanges marchands de considérablement progresser, au niveau de vie global de nettement s’améliorer… Et aussi à la jeunesse de s’affirmer, dans les chansons yéyé, dans le rock comme dans la contestation de l’ordre établi.
Le mot d’ordre implicite, l’espoir partagé, consista à trouver le bien-être dans la « société de consommation », dans le développement d’une classe moyenne urbaine qui, de fait, adoptait un nouveau système de valeurs, que personne n’avait besoin de lui enseigner. L’heure était plutôt à la conquête de nouvelles libertés, notamment pour les femmes : droit pour l‘épouse de disposer de son propre carnet de chèque sans l’autorisation de son mari (1964), droit à la contraception (1967) à l’IVG (1975). La dépénalisation de l’homosexualité, dont on oublie qu’elle est advenue seulement en 1982, se situe dans la même optique. On comprend que le terme de « morale », qui jusqu’alors était extensif et laudatif (c’est toujours le cas quand il est question, par exemple, de l’Académie des sciences morales et politiques) soit devenu restrictif et péjoratif.
Mais, comme il est impossible de réduire l’existence à son aspect matériel, on s’est mis à utiliser un autre mot : « l’éthique ». Il était de bon ton de prétendre qu’il s’agissait de tout autre chose et il ne manquait pas de philosophes pour expliquer cette divergence par une formalisation très sophistiquée. Pourtant, s’il peut être effectivement enrichissant de disposer de deux mots différents, quand la distinction devient un alibi pour noyer la morale avec l’eau du bain, elle s’avère peu fondée et contre-productive. Simone de Beauvoir a parlé, en son temps de « morale de situation ». Et les lois de liberté auxquelles nous venons de faire allusion, auraient pu, avec pertinence, être qualifiées de lois de « morale laïque ». Comme, en son temps, le droit au divorce (1884), que les historiens s’accordent à considérer comme une loi laïcisatrice, elles séparaient la morale publique de normes religieuses catholiques ; ces dernières devenaient des choix « privés », des comportements issus de convictions personnelles et non d’obligations sociales juridiquement et politiquement imposées.
Il est vrai que ces mesures ne faisaient pas que séparer morale civile et normes religieuses : l’autorisation donnée aux femmes à disposer de leur propre argent, le prouve : c’est le conformisme ordinaire dans son ensemble (et toute société a le sien, mais elle progresse par sa transgression) qui se trouvait atteint. Or, contrairement aux idées reçues, tel était déjà le cas dans l’enseignement de la morale laïque de la Troisième République. L’étude de première main des cahiers d’écoliers entre 1882 et 1914 prouve sans conteste que celle-ci est plus contestataire que ce qu’en a retenu le « récit national »[1]. Seulement que peut une démarche de connaissance quand elle va à l’encontre d’un préjugé ? A peu près rien.
Un jugement mémoriel stéréotypé sur la « morale laïque » est devenu prédominant, alimenté par les souvenirs de celles et ceux qui ont subi, enfants, son déclin, quand elle s’est réduite à l’inscription d’une « petite phrase », chaque matin, sur les cahiers des écoliers. On a fait comme s’il en avait toujours été ainsi.
Cependant, expulsé par la porte, le problème de la socialisation morale rentre par la fenêtre, car celle-ci est consubstantielle au fait que les individus font société en se trouvant en étroite relation les uns avec les autres, et non simplement, chacun isolé à une place déterminée, comme des voitures dans un parking. Le leitmotiv de l’ancienne morale laïque : « Les devoirs des uns permettent les droits des autres » (et réciproquement) reste d’une permanente actualité, surtout dans une société démocratique qui, comme le montrait déjà Montesquieu, substitue le « principe de la vertu » au « principe de l’honneur ». Kéren Desmery pose la question, dans son titre d’une « éducation à la liberté responsable ». Là est bien l’enjeu permanent d’une République dont le Préambule de la Constitution fonde le lien social sur un certain nombre de « valeurs ».
Cette exigence de socialisation morale, deuxième raison, est devenue particulièrement aigue avec le grand écart créé par la crise socio-économique. Celle-ci a débuté en 1975 et, avec des hauts et des bas, a perduré depuis lors. Chacun connait bien ses effets les plus visibles : forte augmentation du chômage et des inégalités sociales, incertitudes quant à l’avenir, etc. Mais peut-être n’a-t-on pas été assez attentif au fait que, par ailleurs, l’âpreté de la concurrence, la puissance toujours plus grande de la communication de masse, ont considérablement renforcé une incitation quotidienne, obsédante, à s’épanouir dans la consommation.
Cette injonction englobe tellement la vie quotidienne de chacun qu’elle n’est même plus socialement perçue. Elle est devenue un « allant de soi » pour reprendre l’expression du sociologue Alfred Schütz. L’individu « ordinaire » est écartelé entre les difficultés matérielles de sa vie et les messages publicitaires incessants qui, s’ils avaient un contenu politique, feraient penser que nous vivons dans un régime dictatorial. C’est une autre forme de dictature, beaucoup plus insidieuse, et il faut trouver des instruments qui permettent de pouvoir respirer un petit parfum de liberté… responsable.
Chacun trouve normal que, sur les chaines de télévision privées, la diffusion de « séries télé » et de films soit encadrée et entrecoupée de spot publicitaires et, plus grave encore, que le « service public » triche sans vergogne avec l’obligation de ne plus diffuser de la publicité à partir de 20 heures. Il détourne cette prescription, dans l’indifférence générale, en multipliant de pseudo émissions de quelques minutes, sponsorisées, chaque fois, par différents produits dont on fait, de fait, la « pub ». Alors que les obligations télévisuelles de communier dans des indignations morales, souvent formatées, se multiplient, s’émouvoir de cette situation et de ses conséquences sociétales, apparait incongru. Or, structurellement, la publicité est la parodie de l’espoir, le détournement du sens au profit d’un univers marchand, le formatage d’un individu passif au cerveau conditionné (les fameux « espaces de cerveaux disponibles » dont parlait l’ex-PDG de TF1).
Par ailleurs, le développement de la télé-réalité pousse les enfants et les adolescents à croire que l’on peut devenir, très vite, célèbre et fortuné, sans accomplir aucune œuvre tangible, sans manifester aucun talent, ni faire aucun effort réel. Les stars le sont, souvent, uniquement parce que la communication de masse en a décidé ainsi. La savoureuse prestation de Roberto Benigni dans To Rome with love le montre magnifiquement : la couleur du caleçon ou la manière dont cet être humain ordinaire prend son petit déjeuner, ces choses insignifiantes deviennent des événements d’une ampleur médiatique nationale, puis, bien sûr, retombent dans l’oubli aussi vite qu’ils avaient focalisé l’attention de la foule. Curieusement, Télérama considère ce film comme « un Woody Allen mineur »[2]. Peut-être est-ce une œuvre trop dérangeante pour pouvoir être vraiment appréciée.
[1] Cf. J. Baubérot, La morale laïque contre l’ordre moral sous la Troisième République, Paris, Seuil, 1997, réédit. Archives Karéline, 2009, et « La morale laïque hier et aujourd’hui » in E. Favey –G. Coq (dir.) Pour un enseignement laïque de la morale, Toulouse, Privat, p. 35-65.
[2] L. Guichard, le 25 mai 2013. Le film n’a droit qu’à un seul T (= « on aime un peu »)