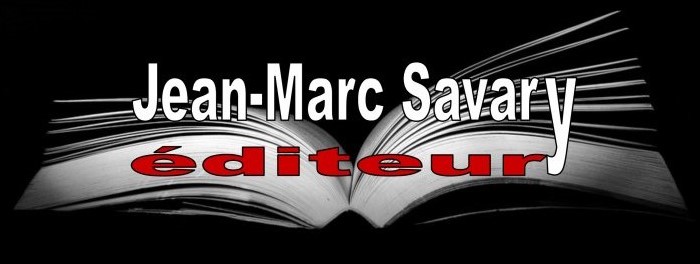Construction - Tome 2 "De la Théogonie à l'agonie"
Réflexions politiquement incorrectes et religieusement hétérodoxes sur la mort de la France.
Réflexions politiquement incorrectes et religieusement hétérodoxes sur la mort de la France.
C'est autour de l'alliance de la Croix et de la Couronne que s'agrégèrent patiemment en un unique Royaume des provinces riches de la diversité de leurs paysages et de leurs terroirs, riches de leurs langues, de leurs dialectes, de leurs traditions, de leurs architectures, de leurs croyances populaires, qui se trouvèrent ainsi, de nature, enracinés dans la terre qui les vit naître, mais unifiées par une même Morale Supérieure les transcendant toutes sans pour autant les effacer.
C'est la Civilisation Chrétienne qui insuffla l'esprit de Chevalerie qui fit que même sur les champs de bataille accorder la grâce et demander rançon à l'ennemi désarçonné était plus noble que l'occire, ce qui eût été souvent plus simple, plus sûr et plus rapide
LES PREMIERES PAGES :
Puisque toutes les civilisations résultent d'une agrégation autour de la Religion, les valeurs portées par cette dernière devant nécessairement prendre corps au travers d'une Politique s'y adossant, donc elle aussi gardienne de la Tradition, la civilisation Chrétienne d'Occident ne fera pas exception à ces principes qui furent l'objet du Livre Premier.
Nous commettons d'ailleurs une erreur en qualifiant de chrétienne notre civilisation, puisque catholique est le terme exact : parmi la multiplicité des courants qui émergèrent aux premiers temps du Christianisme, c'est bien le Catholicisme et lui seul qui finira par s'imposer dans le décor, du moins dans ce qui fut la partie occidentale de l'empire romain.
On ne peut donc comprendre l'essence de notre civilisation que, d'une part, en remontant, là encore, à la source de sa religion fondatrice et en tentant de dégager les raisons de la réussite du Catholicisme plutôt que de l'un de ses nombreux concurrents, d'autre part en ayant à l'esprit la manière dont la Royauté franque puis française, malgré de perpétuelles évolutions et la multiplicité des personnalités qui l'incarnèrent, réussit pendant mille-trois-cents ans à maintenir au cœur de la société les valeurs dont elle fut, au plan temporel, la gardienne.
Il ne s'agit bien évidemment pas dans ce Livre Deuxième d'aller aux détails, dont le lecteur pourra toujours prendre connaissance dans les nombreux livres d'Histoire disponibles, que nous lui conseillons de choisir parmi ceux publiés dans les dernières décennies, tant les clichés véhiculés quasiment jusqu'au troisième quart du XXe siècle ont été quelque peu bousculés par les découvertes récentes et les méthodes d'investigation nouvelles. Il s'agit néanmoins d'essayer dans les pages qui suivent de se faire une idée suffisante des principes fondateurs ayant structuré notre civilisation, pour mieux ensuite comprendre les raisons de son effondrement.
Il nous faudra donc, dans la Première Partie, Le Catholicisme, Colonne Spirituelle de notre Civilisation, remonter à l'origine, soit aux événements qui se déroulèrent il y a deux mille ans au Proche Orient, raison pour laquelle nous évoquâmes dans le Livre précédent les dieux de la Mésopotamie, car il n'y a pas de Christianisme sans Judaïsme, et pas de Judaïsme sans les dieux de Ur et de Uruk : ce n'est ni à Rome ni à Jérusalem que naquit Yahvé, mais entre Tigre et Euphrate, là où la Genèse nous situe le jardin d'Éden et l'appel d'Abraham à quitter sa patrie pour le Proche Orient, ce qui signifie que tout ce qui précède son départ se déroula au pays de Sumer. Là encore, le mythe nous paraîtrait absurde si nous n'en voyions ce que voulurent nous signifier ses rédacteurs au travers de la fable. Pourquoi en effet Yahvé aurait-il demandé au mésopotamien Abraham de changer de contrée, de laisser un pays d'abondance pour une terre moins riche ? Yahvé préférait-il à titre personnel, pour aller se baigner sans doute, les rivages de la Méditerranée à ceux du Golfe Persique ? N'y avait-il pas déjà au Proche Orient des femmes et des hommes aux yeux desquels Il aurait pu tout aussi aisément se manifester, faisant d'eux son peuple élu ? Ou, s'Il trouvait le peuple d'Abraham plus à son goût, faire des mésopotamiens son peuple élu, en quelque sorte sur place ? Pris à la lettre, ce mythe n'a donc ni queue ni tête, mais il fait totalement sens si l'on se penche sur sa signification profonde. Nous l'avons dit : en Mésopotamie cohabitaient des dieux et leurs épouses, qui, à l'exception d'Enlil de par sa place au sommet du panthéon, avaient un statut identique. En quittant ce pays, Yahvé, dont on a vu qu'il avait encore alors sa parèdre, Ashera, tourne par conséquent le dos à ses égaux pour aller s'installer sur des terres dont les dieux pourront être regardés comme inférieurs, comme des idoles, comme des Elilim et non plus comme des Elohim. Le mythe de l'appel d'Abraham et de son installation au Proche Orient est donc l'allégorie du passage du polythéisme au monolâtrisme, avant que plus tard ce dernier ne devienne à son tour monothéisme strict. Ceci ne pouvait se faire en demeurant en Basse Mésopotamie, preuve en est que jusqu'à sa disparition, vers 120 av. J.-C., la civilisation mésopotamienne restera fidèle à ses dieux.
Il nous faudra donc aussi, la religion à l'origine de notre civilisation ne pouvant faire exception en termes de fondations mythiques, séparer le mythe de la réalité et percevoir la seconde derrière le premier, ce qui ne pourra bien évidemment se faire sans que soient heurtés les présupposés dogmatiques de ceux qui en ce domaine auraient tendance à considérer indiscutables la lettre des Textes. S'il se trouvait de tels esprits parmi les lecteurs sur le point de tourner les pages de ce Livre Deuxième, il pourrait être prudent pour eux de placer à portée de leur main une boîte d'antidépresseurs et d'ouvrir les fenêtres pour laisser se dissiper les vapeurs de soufre qui ne manqueront pas de s'échapper des pages suivantes.